Une destination hors du commun
Le complexe de PortAventura World est situé à seulement quelques pas des jolies plages de Salou. Ce parc de loisirs s’est imposé comme une référence mondiale, et attire chaque année des millions de visiteurs venus des quatre coins d’Europe. Avec ses trois parcs à thème,
Ferrari Land, PortAventura Park et Caribe Aquatic Park, les expériences proposées sont tellement variées que chacun y trouve son bonheur, quel que soit son âge.
L’ado en quête de sensations fortes trouve son compte dans les attractions emblématiques telles que Shambhala ou Furius Baco. Les plus jeunes s’aventurent joyeusement dans l’univers coloré de SesamoAventura, tandis que les passionnés d’automobile peuvent s’immerger dans l’atmosphère italienne de Ferrari Land et de son attraction Red Force, la plus haute et la plus rapide d’Europe !
Un tour du monde sans quitter l’Espagne
L’originalité de PortAventura Park réside dans sa conception même : six zones thématiques permettent aux visiteurs de vivre un voyage à travers le monde. On passe ainsi des rues méditerranéennes aux villages polynésiens, avant de plonger dans l’ambiance du Far West.
Le dépaysement se poursuit avec l’exploration du Mexique traditionnel et de la Chine impériale. Chaque univers possède sa propre identité culinaire, prolongeant l’immersion culturelle jusque dans l’assiette. Le restaurant Iron House propose par exemple des spécialités du Far West tandis que le Racó de Mar fait honneur à la gastronomie méditerranéenne.
Des spectacles époustouflants
Si l’adrénaline des manèges attire les visiteurs les spectacles proposés chaque jour fascinent et rivalisent avec les attractions. Aloha Tahiti transporte les spectateurs au cœur des îles polynésiennes avec ses danses traditionnelles envoûtantes. West Gold Frenzy nouvelle production palpitante mêle cascades humour et ambiance Far West pour un spectacle riche en adrénaline. Les plus jeunes quant à eux seront ravis de retrouver leurs personnages préférés lors de la Sesame Street Parade un défilé haut en couleurs et en bonne humeur.
Pour célébrer son trentième anniversaire le parc a innové avec un défilé inédit : la Birthday Parade un spectacle festif et coloré qui clôture chaque journée. Cette parade met en scène des chars spectaculaires représentant les différentes zones thématiques du parc accompagnés de danseurs et des personnages emblématiques tels que Woody Woodpecker et les héros de Sesame Street offrant aux visiteurs un moment magique alliant musique danse et lumière.Le Gran Teatre Imperial accueille désormais Un viaje fascinante un spectacle immersif dans les univers du parc. Quant au traditionnel show FiestAventura il s’enrichit d’une chorégraphie de drones pour une expérience encore plus saisissante.
L’été sous le signe de la glisse
Lorsque les températures grimpent, c’est vers Caribe Aquatic Park que se retrouvent les familles. Cette oasis tropicale offre en effet un cadre dépaysant et rafraîchissant où les différents bassins et les toboggans aquatiques font le bonheur des petits et des grands. Cascades, immenses piscines, végétation luxuriante et plages de sable blanc, le décor caribéen est plus vrai que nature, on s’y croirait… De vrais moments de bonheur dont on se souvient longtemps !
INFOS PRATIQUES
• Durée idéale du séjour : 3 jours et 2 nuits
• Comment s’y rendre ? Depuis Barcelone, un trajet d’une heure (en train ou en voiture) vous mènera aux portes du parc. Des vols directs relient aussi Paris-Orly à l’aéroport de Reus, situé à 10 minutes en voiture du parc.
• Où séjourner ? Une grande variété d’hébergements s’offre à vous. Pour profiter du parc avant même l’ouverture, choisissez l’un des six hôtels situés à l’intérieur du complexe. Pour vous imprégner de la culture locale et des soirées animées des villes voisines, optez pour l’un des quatre hôtels de la marque Ponient Hotels exploités par PortAventura World à Salou ou à Vila-seca.
• Plus d’informations : portaventuraworld.com



 Comment commence une histoire ?
Comment commence une histoire ?


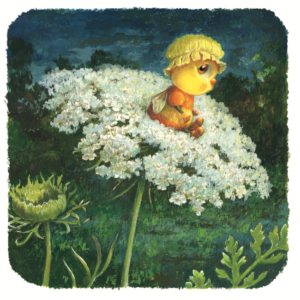 Pourquoi avoir choisi de si petits animaux ?
Pourquoi avoir choisi de si petits animaux ?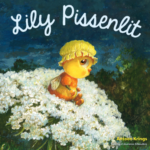
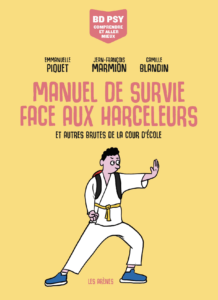
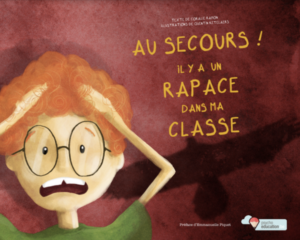 Ce livre s’inspire d’une part de la stratégie des flèches de résistance proposée par Emmanuelle Piquet, thérapeute spécialisée dans les souffrances scolaires et auteure de nombreux ouvrages sur le sujet, et de l’autre des techniques de répartie proposées par Geneviève Smal et son jeu
Ce livre s’inspire d’une part de la stratégie des flèches de résistance proposée par Emmanuelle Piquet, thérapeute spécialisée dans les souffrances scolaires et auteure de nombreux ouvrages sur le sujet, et de l’autre des techniques de répartie proposées par Geneviève Smal et son jeu